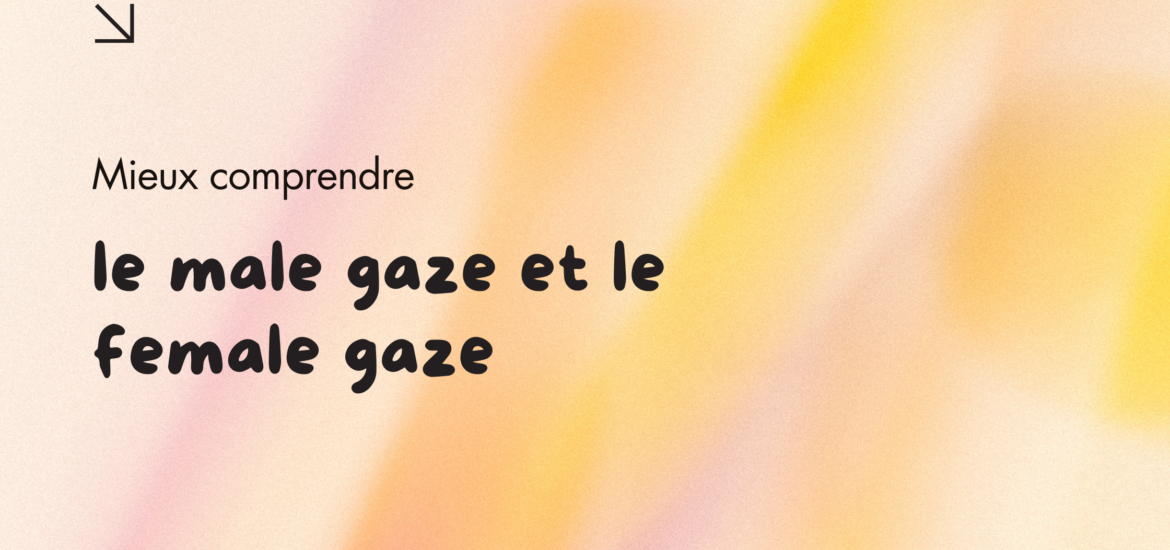Le rapport qu’ont les femmes et les personnes queer au vêtement me fascine depuis toujours. Comment il transforme, comment il est pensé pour plaire ou ne pas plaire, pour être regardé.e ou pour disparaître.
Plaire, être regardé.e…Oui, mais comment ?
Ce dernier point constitue toute la raison pour laquelle j’aborde aujourd’hui la question du male gaze et du female gaze* – ces regards dont on entend beaucoup parler depuis 4-5 ans mais que l’on peine parfois à définir** tant ils se sont éloignés de leur terrain de théorisation première : le cinéma.
Alors, faisons le point ensemble. Avant d’entamer une série de contenus sur les regards que l’on porte sur soi et sur autrui, à travers le vêtement.
*voir mon premier article sur le male gaze, publié en octobre 2020.
**je reviendrai sur ce point plus bas.
Disclaimer : je ne suis ni sociologue, ni spécialiste du cinéma. Je suis juste une passionnée de sociologie de la mode et de féminisme, qui aime comprendre les choses et les partager de la manière la plus accessible possible.
Qu’est-ce que male gaze et female gaze veulent dire ?
“Gaze” signifie “regard”, en anglais. Le male gaze, c’est le regard masculin.
Ainsi, female gaze veut dire “regard féminin”.
En 1975 (ou 1973, les deux dates semblent valables), Laura Mulvey – critique cinématographique et réalisatrice – conceptualise le terme de male gaze dans son essai Visual Pleasure and Narrative Cinema.
Il s’agit d’une critique du regard dominant qui participe au développement des représentations. Le regard dominant dans le cinéma et les séries étant le regard masculin, qui a pour seul objectif de satisfaire le désir des hommes et plus largement, de la société patriarcale. Laura Mulvey souligne les répercussions que ce male gaze a sur les représentations et les stéréotypes de genre.
De cette conceptualisation du regard masculin en 1975, découle une théorisation du female gaze par les philosophes et sociologues féministes – reprise et développée en 2016 par Joey Soloway, dramaturge américaine. Le regard féminin était d’abord une contradiction au male gaze mais son concept a évolué aujourd’hui pour proposer… autre chose.
Ok et plus précisément, en quoi le male gaze et le female gaze sont-ils différents ?
Les deux types de regard s’articulent autour de 3 points :
- la perspective de la caméra
- celle du personnage
- et celle des spectateurices.
Le regard masculin
Avec son objectif de satisfaire les désirs des hommes, la caméra du point de vue du male gaze décortique les corps – en particulier les corps féminins, tandis que les personnages féminins sont des objets à désirer et positionne les spectateurices comme des voyeurs et voyeuses. Pour ce dernier point, Laura Mulvey s’est appuyée sur la théorie freudienne de la scopophilie : le plaisir de regarder sans être vu.e.
Le male gaze, c’est voir des bout de fesses, des bouts de corps à désirer (sans avoir le choix du désir, c’est imposé), c’est une incapacité à s’identifier aux personnages féminins qui ne sont qu’objets de désir et c’est regarder à l’insu de. Pour moi, c’est très patriarcal dans le sens où c’est entièrement déconnecté d’empathie et d’émotions bienveillantes, considérées comme “faibles” car reléguées au rang de la féminité.
Le regard féminin
Le female gaze, ce n’est pas l’inverse, c’est autre chose.
C’est une caméra qui filme dans un contexte, dans une entièreté, sans morcellement des corps. C’est un personnage féminin qui devient sujet : qui ressent, qui désir, qui vit et qui bouge. C’est un.e spectateurice qui ressent également, qui parvient à se mettre “à la place de”, dénoué de voyeurisme. C’est désirer en dehors d’un schéma de domination, des stéréotypes genrés et dans d’autres propositions de représentations. Selon Iris Brey***, c’est “sortir du statut d’objet contemplé”.
***Iris Brey est journaliste et autrice notamment de l’ouvrage “Le regard féminin, une révolution à l’écran” que j’ai étudié dans le cadre de cette série de contenus autour du male gaze et du female gaze.
Qui peut avoir un regard féminin ?
Il ne suffit pas d’être une femme pour avoir un regard féminin ou d’être un homme pour un regard masculin.
Un réalisateur peut proposer un film avec du female gaze tandis qu’une réalisatrice peut continuer à morceler les corps.
Encore selon Iris Brey, le female gaze c’est aussi avoir conscience de son regard et proposer une autre manière de filmer et de raconter une histoire. C’est en cela que j’ai demandé à Clara Baudry de raconter son expérience de réalisatrice et photographe :
Je ne me pose pas la question du female gaze quand je fabrique une image.
En revanche, j’essaye de conscientiser mon geste artistique. Au-delà de l’image que je produis, c’est tout ce qu’il y a hors du champ de la caméra qui m’intéresse.
Dans quelles conditions sont réalisées les images ? En particulier, lorsque l’on travaille avec des corps nus (ce qui est mon cas), est-ce que le consentement est respecté ? C’est un point central.
Je pense que lorsqu’on laisse toute la place à une collaboration saine, on produit forcément une image différente (dans le fond et la forme), de ce qui a été fait et qui perpétue encore aujourd’hui – où le patriarcat domine la manière de travailler en banalisant les violences, en objectifiant les personnages, en omettant leur ressenti, autant dans le processus de réalisation que dans ce que véhicule une image.
Pour moi, c’est ça le female gaze : c’est avoir conscience de sa place et de celle des autres en les considérant avec empathie et bienveillance.
Finalement, c’est être féministe.
D’accord. Mais c’est quoi le problème avec le male gaze et le female gaze ?
Female gaze
Justement, le problème avec le female gaze c’est qu’on va souvent le réduire au fait d’être une femme – comme si ce genre était imperméable au système de domination patriarcal. J’ai également lu des bêtises proposées chez Pastel Media (qui par ailleurs est un media que j’apprécie), justifiant qu’un film est sexiste en le réduisant à l’utilisation du test de Bechdel****. Or, seul le test de Bechdel ne suffit pas pour qualifier un film ou une série de féministe ou sexiste. Il faut nécessairement considérer ce female gaze.
****Test de Bechdel : vise à mettre en évidence la sur-représentation des protagonistes masculins ou la sous-représentation de personnages féminin dans une œuvre de fiction.
Male Gaze
Quant au male gaze, les problèmes qui en découlent sont beaucoup plus évidents – surtout à la lecture de l’ouvrage d’Iris Brey :
- Il façonne un regard dominant et objectifiant que l’on porte sur les femmes
- il laisse à croire qu’une femme ne s’identifie qu’en rapport à un homme
- et il banalise les comportements dominants et violents (un long chapitre est consacré aux violences sexistes et sexuelles et leurs représentations dans la culture audiovisuelle).
Je développe ces points dans mon premier article sur le male gaze.
Que fait-on maintenant ?
L’intérêt de cet article est de poser les bases d’une série de contenus (à voir sur mon compte Instagram) sur le female gaze et le male gaze à travers le vêtement.
Bien que théorisés à partir de la culture cinématographique, ces regards peuvent s’étendre à la littérature, l’art, et pourquoi pas… la mode.
Ce que je trouve intéressant, c’est d’avoir conscience de ces regards, de leurs rôles et des possibilités qui existent pour créer autre chose. Car, fondamentalement, le female gaze permet surtout aux personnages féminins de passer d’objet de désir à sujet de désir. Un sujet de désir qui ressent, qui consent, qui respire, qui crie et qui prend sa juste place. Si on peut définir le fait d’être sujet ainsi. Et les possibilités qui existent en étant sujet ne sont-elles pas illimitées ?
Si tu as aimé ce contenu, n’oublie pas de soutenir mon travail en l’exprimant à travers un like, un commentaire et un partage. Pour la suite, n’oublie pas de t’abonner !
Sources :
https://www.newyorker.com/books/second-read/the-invention-of-the-male-gaze
https://study.com/academy/lesson/the-male-gaze-definition-theory.html
https://blog.adatechschool.fr/female-gaze
https://www.editionspoints.com/ouvrage/le-regard-feminin-iris-brey/9782757887998
xoxo
Elena sans H